N’en parlons plus, veux-tu !
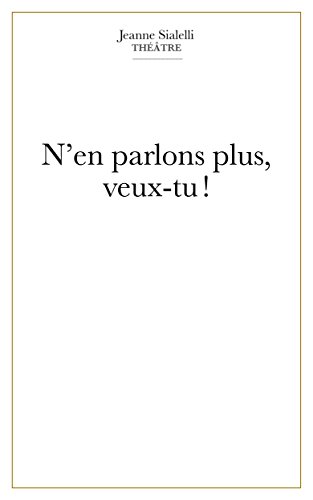
Jeanne Sialelli
N’en parlons plus, veux-tu !
Théâtre
Deux personnages. Marguerite, trente-deux ans, et Bruno, quarante-cinq. Jeu de lumières à trouver pour différencier les moments où ils parlent au public ou à eux-mêmes, et les moments de fantasme, indiqués en rouge.
L’action se situe dans les années 1975-1980; elle est racontée vingt ans plus tard.
Rideaux fermés.
Voix off de Marguerite.— Ma chérie, par où commencer ? Pendant longtemps, très longtemps, je me suis demandé ce qu’il fallait que je te dise, et quand je le ferais. Les mots tournaient dans ma tête.
Les souvenirs… Il n’y a rien de plus trompeur que les souvenirs ; même les faits, les faits les plus simples, sont difficiles à raconter, alors imagine ! En plus, il y a ce qui n’a pas été dit, ce que j’avais dans la tête à ce moment-là.
J’étais jeune, à peine trente ans, 68 était passé par-là depuis peu, et je quittais Philippe, le père d’Antoine.
Je crois que j’aurais pu tout oublier.
Non, c’est impossible ! Cette douleur, cette violence… mais j’aurais peut-être pu vivre sereinement avec ce souvenir.
Ce sont leurs questions, insidieuses, quelquefois brutales, qui résonnent encore en moi. Que pouvais-je leur dire d’autre que les circonstances ? Elles sont déjà si surprenantes.
Plusieurs voix off se superposant les unes aux autres.
— Reprenons, madame. Vous me dites que vous avez pris le train de Tours pour Gueret via Paris et que vous alliez chez une amie ?
— Mais alors que faisiez-vous dans le train pour Paris quatre jours après ?
— Elle se fout de nous, ça ne tient pas debout !
— Pourquoi ce revirement ? Dis-le, que tu le cherchais.
— La vérité, tu la craches ou non ?
— Lui ? Pourquoi lui ?
— Vous vous étiez déjà rencontrés avant ? Où ?
— Ça ne tient pas debout ! Qu’est-ce que tu caches ?
— Bon, on reprend tout !
Silence complet, brutal.
Voix off de Marguerite.— Je commence par le commencement, tu verras, ce n’est pas si compliqué…
Le rideau s’ouvre. Un compartiment de train, l’ébauche des deux autres de chaque côté ; le couloir est en bord de scène.
Fond sonore de gare : brouhahas, piétinements, voix d’enfants, d’adultes qui cherchent leurs places.
Voix off. Le train n°5634 à destination de Brive la Gaillarde va partir ; prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Ce train desservira les gares de Vierzon, Limoges, Gueret.
Un homme, Bruno, est déjà assis sur une banquette contre la fenêtre, en fond de scène ; on ne voit que sa silhouette, il est caché derrière un journal grand ouvert.
Marguerite, arrive essoufflée, pas maquillée, les cheveux sur les épaules, avec une assez grosse valise, des sacs de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Elle laisse tout en plan et s’assoit sur la banquette en face, voit Bruno, s’adresse à lui.
Marguerite.— Bonjour
Bruno, sans quitter des yeux son journal.— Bonjour
Elle souffle, se relève, retire son manteau ; superposition de vêtements, un peu bohème. Elle range ses sacs en haut, dans le filet, veut faire de même avec la valise, n’y arrive pas, se décourage, la laisse entre les deux banquettes. L’homme n’a pas bronché.
Elle se rassied, reste immobile ; le temps passe. On la sent épuisée ; elle se relève, va dans le couloir. Face aux spectateurs.
Marguerite.— Bien ma chance ! Quatre heures à passer avec un rustre de la pire espèce. Faux-cul qui fait semblant de ne pas me voir.
Elle prend une cigarette, l’allume et la cigarette au bec, ouvre la fenêtre.
Un peu d’air, ça me fera du bien ; quelle journée ! Je n’en peux plus. S’il croit que cette fois-ci je vais revenir, il va être surpris !
Ça a été dur, une pareille décision… mais un jour, aujourd’hui, elle s’est imposée ; je n’avais plus le choix, il fallait partir.
Le pire a été le temps qu’il m’a fallu, après, pour ouvrir la porte et filer : j’ai hésité, ce n’était jamais le jour, jamais le moment, tout allait peut-être s’arranger. Des nuits blanches, des insomnies.
Enfin ! j’y suis arrivée. Je suis moulue.
Une cigarette, il n’y a rien de mieux qu’une cigarette.
Un temps. Marguerite, toujours face au public.
Je dois être affreuse. Des nuits à me demander quand j’en aurai le courage. Des angoisses horribles ; il dormait à côté de moi, tranquille, refusant de voir les problèmes. « Mais qu’est-ce que tu veux de plus ? » était son refrain. Ce que j’ai pu le haïr alors.
Des années entières de vie commune, et tout remettre en question, tout envoyer balader. Je suis folle.
Vie commune, vie commune… vie de merde, oui ! Lui, toujours lui ; et moi qui n’étais plus rien, tentant de jouer un rôle pour lequel je n’étais pas douée : la gentille, l’efficace, la mère, l’amie, aux petits soins du maître-mari. Je tourne la page mais j’ai peur ; curieux, je me sens forte et j’ai peur, une peur terrible ; l’abîme devant moi. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire.
Je verrai bien.
Bruno a laissé tomber son journal sur ses genoux. Il est dans son monde et semble anxieux.
Marguerite, toujours dans le couloir. - Si je commence à me poser des questions, jamais je ne m’en sortirai. L’oublier, tout faire pour l’oublier et repartir à zéro. J’ai fait le plus dur, il faut avancer maintenant, mais où, comment ? Heureusement que j’ai mon job et Antoine.
Silence. Puis, rapidement, comme s’il y avait urgence, elle rentre dans le compartiment, s’assied, fouille dans son sac, en sort une trousse de maquillage, se lève, disparaît dans le couloir.
Bruno veut sortir, heurte la valise, hésite à l’enjamber, finalement la monte dans le filet. Il sort dans le couloir.
Bruno. - Quel tourbillon cette femme ; fatigante, ce serait bien qu’elle se calme. Elle en a déjà mis partout. En plus, elle fume. Ce doit être une bavarde, une agitée.
Il faudrait que je me mette sur mon dossier, pas le courage, comment établir une défense qui se tienne ? Ils ont tous des versions différentes ; il n’y a qu’une seule chose qu’ils partagent, c’est la connerie, et ce n’est pas un argument. Du coup, personne ne sera satisfait du verdict. Et c’est quasiment toujours comme ça.
Il regarde par la fenêtre un bon moment.
Moi qui voulais être paysan comme le père Morot, ils en ont décidé autrement. Les études, ils n’avaient que ce mot-là à la bouche ; ils ont été contents du résultat. Ils sont morts maintenant, et moi aussi, quasiment.
Tracer la ligne droite avec mon tracteur et ne pas me poser de problème. Avancer, toujours avancer, planter, récolter, se laisser guider par les saisons et n’être emmerdé par personne. Trop tard maintenant. Les parents sont les assassins des rêves de leurs enfants.
Marguerite réapparaît sur la gauche, maquillée, cheveux relevés, bijoux, et regarde de loin l’homme debout dans le couloir. Elle s’avance vers lui ; il ne la voit pas.
Marguerite. — Tiens, il est là, lui. Bel homme ! vraiment pas mal quand il est déplié ; beau profil. Quel âge peut-il bien avoir ? aucune idée. Vieux jeune homme ou fringant vieillard ? difficile de trancher, il ne ressemble à rien. Un gros ours renfrogné qui hiberne.
Pourtant le printemps est là.
Marguerite entre dans le compartiment, voit que sa valise a été montée. Elle se cale contre la banquette, ferme les yeux.
Bruno toujours debout dans le couloir, regardant de temps en temps à droite ou à gauche.
Bruno.— C’est pour ça que je n’ai jamais voulu avoir de gosses. Je ne voulais pas faire comme eux, comme tous les parents qui n’ont rien réussi et tentent de se rattraper au travers de leurs enfants.
En plus, la belle affaire : voir sa femme devenir une baleine, ne plus parler que d’accouchement, de vergetures, de Blédine et autres ; car c’est ça, à la minute où elles sont habitées, nous, on est expulsés ! finis ! on laisse la place à l’enfant-roi ; alors, pour ne pas perdre la face, on fait comme les autres : on s’extasie devant le rejeton qui braille et nous pourrit la vie.
On doit sûrement finir par l’aimer ; enfin, peut-être. En tout cas, pas pour moi.
À peine vous commencez à être bien avec une femme que la question vient sur le tapis. On les voit arriver ; toutes ; il suffit qu’une de leurs amies en ait pondu un, et crac, c’est contagieux, il leur faut le leur. Et c’est le début de la fin !
Silence ; il regarde au loin.
Oui, paysan, j’aurais aimé être paysan. Là, les gosses c’est moins gênant, on les élève avec le reste, et il y a des chances qu’ils ne deviennent pas des petites frappes, des voyous.
Bruno entre dans le compartiment. Marguerite ouvre les yeux en le sentant passer.
Bruno.— Pardon, je ne voulais pas vous réveiller.
Marguerite.— Je ne dormais pas. Au fait, je vous remercie pour ma valise.
Bruno.— C’est normal, elle est lourde.
Bruno se rassied, tire la tablette, sort d’un cartable des dossiers, en ouvre un et se met à travailler. Elle l’observe. D’abord discrètement puis avec de plus en plus d’attention.
Marguerite, qui veut entretenir la conversation.— Vous allez à jusqu’à Brive ?
Bruno.— Oui.
Marguerite.— Je m’arrête avant mais je connais Brive ; C’est une jolie ville, elle est aérée ; la ville à la campagne, l’idéal ! Il y a des parcs partout, la cathédrale est superbe ; vous connaissez l’abbaye de … ? Zut, je ne m'en souviens plus ! C’est à côté, c’est magnifique.
Bruno.— Connais pas.
Marguerite.— Allez-y, c’est un endroit magique ; cela n’empêche pas les tragédies. On dit qu’autrefois, il y eut un très grand mariage au château, mais la fille du seigneur disparut le soir de ses noces, et ce n’est que deux siècles plus tard qu’on la retrouva, dans une oubliette, toujours vêtue de sa robe de mariée. Une belle histoire, non ?
Bruno.— Voilà un malheureux qui y a échappé !
Elle rit, cela le déride, il sourit à son tour et se replonge dans son dossier.
Marguerite voulant à tout prix continuer la conversation.— C’est également dans cette ville qu’il y eut une fameuse empoisonneuse. Sept maris, sept occis ! Du beau travail !
On dit aussi qu’au Moyen Âge, toute la ville fut passée au fil de l’épée, question de religion je crois, alors en juin, je ne sais plus si c’est le 17 ou le 27, il ne faut pas mettre le nez dehors : les fantômes la hantent. Vous êtes superstitieux ?
Bruno.— Je ne crois que ce que je vois.
Marguerite.— Vous vous appelez Thomas ?
Bruno.— Quoi ?
Marguerite.— Saint Thomas, Jésus-Christ, celui…
Bruno.— Oui, oui je sais ; foutaises tout ça.
Il fronce les sourcils et montre bien son agacement.
Elle se lève, part dans le couloir, s’allume une cigarette, le regarde en coin.
Marguerite.— Pas facile ! Pire qu’un ours !
Pour elle–même.— Une bonne tête, oui il a une bonne tête, quelques rides, c’est chouette, ça lui va bien même s’il n’a pas l’air très en forme. Il me plaît assez ce type. Ses lèvres, ses mains. Il se dégage de lui une sorte de magnétisme, mais il est dans son monde, dans ses papiers, il ne me voit même pas. À croire que je suis transparente.
On n’a peur de rien avec un mec pareil. C’est un homme comme ça qu’il me faut. Une grande armoire à glace rassurante. J’ai peur de la solitude, je ne la voulais pas, elle va me tomber dessus, je ne sais pas faire.
Bel homme y'a pas ! ramassé sur lui-même ; je le décoincerais bien ! Qu’est-ce qui a bien pu lui arriver ? Il n’a pas la superbe des autres, des matamores, des machos, des grandes gueules et petites bites que je connais. Il est là, comme par hasard, il ne la ramène pas ; un homme perdu ? non, plutôt un renfrogné solitaire
Lui mettre la main au paf ? C’est pas le genre ! il appellerait au secours ! Manière douce, romantique ? le prendre dans mes bras, lui chuchoter quelques mots à l’oreille, le voir se déplier et revivre… Impensable aussi, il ne fait rien pour, aucune approche n’est possible. Il n’est pas là, il est dans ses dossiers, dans un ailleurs que je ne connais pas.
Ses mains… belles mains… ouah ! là ! sur moi !
Marguerite au public, confidence.
C’est la première chose que je regarde chez un homme. Les mains ! Il les a grandes, carrées, enveloppantes.
Pour elle–même. -Il me prendrait le visage et doucement, doucement‑...
Marguerite au public, dubitative, mimant l’effarouchée puis très sérieuse, en crescendo.— Qu’est-ce que je ferais ? Monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez ! et blablabla.
Il est dommage qu’on ne cède jamais à ses pulsions ; ils nous ont formatés, nous ont coupé les ailes. Nous ne sommes plus que des robots et obéissons au sacro-saint savoir-vivre. Je t’en foutrais moi ! C’est du savoir-mourir-à-petit-feu qu’on nous enseigne dès la maternelle.
En articulant, comme si c’était une leçon apprise par cœur, puis très vite.
Il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas faire part de ses envies, exploser de vie, hurler dans le vent. Tout ceci est in-con-ve-nant.
Résister à la tentation, quoi qu’il arrive ! Dire merci, bonjour et au revoir, masquer ses sentiments, dire oui quand on pense non, apprendre les règles, les conventions, les usages, sur le bout des doigts, et tout le reste !
Ouf ! on y a tous eu droit mais on a su aussi s’en affranchir ! Sous les pavés, la plage !
Silence, elle passe et repasse lentement dans le couloir ; nombreux regards furtifs vers lui.
Marguerite, pour elle–même. -Il n’y a pas à dire, cet homme me plaît. Il a quelque chose de touchant, d’inachevé, qui contraste avec son allure de bourgeois bien comme il faut. Grand, costaud. C’est un mâle, un sacré beau mâle aux épaules larges, un mâle contre qui toutes les femmes rêveraient de se pelotonner ; figure de l’homme stable, l’homme solide, le roc, et dans le même temps, il est l’enfant perdu, le marin oublié, le géant à terre. Cet homme me plaît. Plus je le regarde, plus je pense que je n’irais pas dormir dans ma baignoire s’il venait coucher chez moi !
Elle rentre à nouveau dans le compartiment.
Marguerite, tentant de le draguer.— Vous allez à Brive pour vos affaires ?
Bruno.— Oui.
Marguerite.— Dans quelle branche travaillez-vous ?
Bruno.— Juriste.
Marguerite, — Alors vous êtes avocat ? Juge ? Les divorces ou les affaires ? Il y a toujours du boulot pour vous ; tenter de toujours trouver un responsable est un sport national. On se tord le pied dans la rue, on va chercher le maire ; on crève à l’hosto, y’a pas photo, c’est forcément la faute de quelqu’un. Même la mort, on s’y refuse ; une intruse ! En attendant, vous ne devez pas chômer.
Vous arrivez à garder un peu de temps pour vous ? À sortir ?
Bruno.— Non.
Marguerite.— Dommage. Dommage pour vous, dommage pour votre famille, vos enfants. Vous êtes marié ?
Bruno.— Non.
Marguerite.— Je vous dérange avec toutes mes questions ; elles font passer le temps, et puis, faire connaissance, c’est quand même plus agréable puisqu’on va passer quelques heures ensemble.
Vous venez avec moi ? Je vais me prendre un sandwich.
Vous voulez que je vous en rapporte un ?
Bruno.— Non merci, ça va, j’ai du travail.
Marguerite.— Ça n’empêche pas ; moi, j’ai une faim de loup.
Elle part, rieuse. - Curieuse journée, je vous la raconterai… peut-être !
Marguerite sort, elle s’arrête et s’adresse au public. -Pas facile le bonhomme !
Pour elle–même.— Il me plaît de plus en plus cet homme ; silencieux, certes, mais je ne sais pas, il a ce quelque chose qui me fait frémir, et Dieu sait que je n’ai pas frémi depuis longtemps ! Je me mets à fantasmer à mort ; à tout imaginer. Sa bouche… bien dessinée, sensuelle ; sa bouche et ses mains… ses mains, toujours elles… ses mains sur moi… Il me sauterait là, ni vu ni connu ! Pour me laisser faire, j’me laisserais faire !
Marguerite semble sortir d’un rêve, se reprend. Au public.— Bon, il faut que j’arrête de rêver ; ce serait fou, complètement fou, que le jour où je quitte l’autre, je fasse une rencontre… Cinéma, je me fais du cinéma, il ne me regarde pas, ou à peine.
Elle part.
Bruno continue à travailler, ferme un dossier en soupirant, se frotte les yeux de fatigue, s’étire, se lève et vient dans le couloir, prenant le public à témoin.
Bruno.— Pourvu qu’elle ne revienne pas de sitôt, elle me donne le tournis cette femme. Je sens son regard sur moi, continuellement, c’est insupportable. Ce n’est vraiment pas le moment : les femmes, pas le temps de m’en occuper.
Fringuée comme l’as de pique. Des tas de trucs sur le dos, les uns sur les autres. Je n’ai aucune envie d’entamer une conversation, encore moins d’être aimable.
Une frapadingue sûrement. Si elle croit que je ne vois pas son manège. Je vais changer de place, me mettre sur le même côté qu’elle, elle n’osera pas se tordre le cou pour m’observer.
Qu’est-ce qu’elle peut bien vouloir ?
Maigrelette, elle ressemble à une chèvre hirsute. Et son sac ? Un cabas immonde, informe ; des papiers qui en sortent, un livre, et quoi d’autre encore ? un fourre-tout innommable.
En plus, c’est une bavarde et je n’aime pas les bavardes.
Après avoir regardé attentivement à droite et à gauche, il rentre dans le compartiment en maugréant. Il reprend ses papiers.
Le monde est mal foutu, des problèmes partout, des injustices, des salauds qu’il va me falloir défendre au nom de quel droit ? je me le demande bien… Et des écervelées comme elle.
Les femmes… Décidemment, je ne comprends rien aux femmes…
Marguerite surgit, encore survoltée. — Coucou, c’est moi, je vous ai rapporté des M&M’S, j’adore ça. Tiens, vous avez changé de place ! Du travail, encore du travail… Vous êtes un bourreau de travail ! Moi, ce que j’aime, ce sont les bouquins. En ce moment, je lis un livre formidable, écrit par une femme, une histoire vraie, tellement vraie : une vieille dame entre dans une maison de retraite, ses trois filles l’accompagnent. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la vieille dame est très sereine, elle va vers l’inéluctable ; ce sont ses filles qui sont toutes chamboulées.
Marguerite continue de parler tout en grignotant des M&M’S. -Entre peur de la mort (elles sentent leur tour bientôt arriver), défense de leurs intérêts (histoire d’héritage et de gros sous) et remontée de toutes les querelles non réglées, il y en a pour tout le monde !
Vous avez encore vos parents ?
Bruno.— Oui
Marguerite.— C’est une chance ; moi, j’ai perdu ma…
Bruno la coupe brutalement.— Excusez-moi, j’ai un rapport à faire, urgent.
Marguerite, penaude comme une petite fille qu’on a punie.— C’est moi qui m’excuse, je suis désolée, un peu perturbée en ce moment. Je vais griller une cigarette ; je vous laisse tranquille.
Elle sort, s’embrouille, manque de tomber, se rattrape, ferme la porte.
Marguerite au public. — Idiote ! je suis une idiote, j’ai tout gâché. J’ai peur, je suis timide, oui, je suis timide. Je ne supporte pas le silence, impression de vide, angoisse, c’est comme ça, alors je parle, je raconte n’importe quoi, ce qui me passe par la tête. Je voudrais tellement créer le contact avec lui. Il a les yeux mordorés, c’est rare, c’est beau, c’est sexy en diable !
Elle se penche, regarde dehors.
La campagne est sinistre, ici, plate comme la main ; que peuvent bien faire les gens qui habitent ces trous ? Loin de tout, dans la boue, une horreur !
Pour elle–même.
— Toujours dans ses dossiers… il n’y a rien à faire, il m’hypnotise ; comment, comment l’accrocher, qu’il me voit enfin.
J’ai envie de lui ; ça monte… ça monte… Chambardement ; tout le corps en ébullition !
S’il n’y avait que ses mains, ses mains que je ne peux pas imaginer ailleurs que sur moi, dans moi ; mais j’aime sa voix aussi ; ce n’est pas qu’il parle beaucoup, mais elle est chaude, un peu voilée, j’aime !
Elle ferme les yeux, toujours dans son fantasme.
Il se lève, il arrive, il ouvre la porte du compartiment, il m’attrape, me bascule à l’intérieur, sur la banquette, m’embrasse, là, partout, partout, retrousse ma jupe… Oui, oui… encore ! encore ! vas-y !
Elle se recroqueville un peu sur elle-même, mains serrées entre les jambes, visage mi attente mi plaisir. -Je le veux, je le veux, je l’aurai.
Bruno sort. Coup d’œil attentif à droite et à gauche, il la retrouve dans le couloir. Je suis désolé, j’ai été un peu bourru tout à l’heure. Du travail. Merci pour les bonbons.
Il part plus loin dans le couloir ; elle marque un grand signe de joie, du style « C’est gagné ».
Marguerite passe sa langue sur ses lèvres, bombe la poitrine, lisse sa jupe, marmonne à nouveau un :— Je le veux, oui, je le veux.
Il revient et reste à côté d’elle dans le couloir. Marguerite ne peut se retenir
Marguerite.— Vous habitez à Brive ou vous ne venez que quelques jours pour vos affaires ?
Bruno.— Je n'y reste, si tout se passe bien, que deux jours, trois au plus. Je suis basé à Paris.
Marguerite.— Paris… la Ville Lumière, la ville de tous les possibles, j’en rêve ! Paris… la ville des amoureux !
Bruno.— Belle idée, mais la réalité est plus noire : les loyers, la pollution, le stress…
Marguerite.— Et alors ? ON Y VIT !
Il est sur le point de repartir, elle continue. Moi, je fais un break, je reviens ici, je ne sais pas pour combien de temps ; deux ou trois semaines maxi, chez une amie, ma meilleure amie, on se connaît depuis l’école.
Je me cache.
Je viens de quitter mon mari, il va être fou, c’est un violent, archi violent, qui n’aime pas qu’on lui résiste. Alors je prends la tangente !
Bruno.— Ce n’est sûrement pas facile.
Marguerite.— Ah non, il m’a fallu du temps pour tourner la page. On ne sort pas indemne de plusieurs années de vie commune.
Bruno.— Vous m’avez l’air pourtant en forme.
Marguerite.— Mieux vaut en rire qu’en pleurer. Les clowns aussi ont l’air gai. À un moment, j’ai décidé que le rire serait ma béquille ; sans elle, je boîte, et Dieu sait que j’ai claudiqué un moment ! C’est fini, à moi de jouer, et à moi de jouer toute seule.
Il ne répond rien. Silence.
Mais vous, parlez-moi de vous.
Bruno.— Il n’y a vraiment rien à dire. Boulot, sport, boulot encore, les clients, les dossiers, les voyages, les audiences.
Marguerite.— Pas drôle en effet.
Bruno.— Non, pas très.
Marguerite, s’approchant de lui.— Et… pas de femme ?
Bruno.— Non, les femmes, j’ai donné aussi…
Marguerite, avec un signe du petit doigt.— Vous n’êtes pas…
Bruno, riant.— Non, je ne suis pas homo ; les femmes ne sont pas ma priorité en ce moment mais je les aime bien !
Il prend une grande inspiration. Break terminé, j’y retourne ; le travail…
Il rentre dans le compartiment, Marguerite est restée dans le couloir.
Marguerite.— Ouh ! ça va être dur ! Je me sentais bien contre lui, il suffisait d’un rien.
Le voyage ne fait que commencer, encore trois heures pour le séduire. Pas facile le monsieur !
J’adore son eau de toilette, H pour Homme ; je la reconnais entre toutes ; ça, et la musique grecque, je fonds, je ne peux pas résister. Pour la musique grecque, je repasserai, pour lui, il faut que je passe à la vitesse supérieure, mais par où l’accrocher ? Je ne sais toujours rien de lui, ou si peu.
Pour elle–même.
— Intuition, elle ne me trompe jamais mon intuition ; c’est mon homme. Ça palpite là-dedans ; j’ai le ventre en feu, tous les diables de la terre, la bouche sèche, tous les symptômes ! Je deviens folle.
Marguerite, se moquant d’elle-même.— Le coup de foudre, c’est le coup de foudre ! on va se marier et avoir une ribambelle d’enfants !
Pour elle–même.
— Rebelote ! Commençons par le commencement : comment je lui saute dessus ? Comment lui faire ouvrir les bras, me prendre, me serrer, m’enlever, me faire l’amour, me faire crier, jouir, crier, oui, rien que ça. Juste ça…
Marguerite hésite, rentre dans le compartiment. Elle se met à lire tout en observant Bruno du coin de l’œil.
Marguerite, qui veut recréer le dialogue. - Vous savez à quelle heure on arrive ?
Bruno.— Pas exactement ; c’est écrit sur votre billet.
Marguerite, joueuse.— Dans un train, comme dans un avion, entre deux endroits, entre deux vies, on n’est nulle part. Alors il peut tout arriver, non ?
Bruno.— Que voulez-vous qu’il arrive ?
Marguerite.— Je ne sais pas. Une rencontre, un coup de foudre, ou la mort peut-être ? Quelque chose d’inhabituel.
Vous pourriez être un assassin, me zigouiller, refermer la porte, les rideaux, personne ne s’en apercevrait.
Bruno, qui tombe des nues.— Vous êtes folle, quelle idée ! Pourquoi je ferais ça ?
Marguerite s’amusant et le provoquant.— La folie : je vous plais, vous me sautez dessus, je résiste, vous me tuez ! Je ne sais pas si vous m’étranglez ou si vous m’étouffez avant ou après m’avoir violée !
Attention, pas d’hémoglobine, ça me fait tourner de l’œil !
Bruno.— Ça va pas ? Quel cinéma vous faites là ; vous êtes…
Tout dans son expression laisse penser qu’il allait dire timbrée, mais elle le coupe.
Marguerite provocante.— Pourquoi, je ne vous plais pas ?
Bruno, imperturbable.— Là n’est pas la question ; je n’ai pas envie de vous draguer et encore moins de vous tuer !
Marguerite, continuant à jouer.— Ouf ! Et si moi je le faisais ?
Bruno.— Quoi ?
Marguerite.— Vous dra…
Bruno la coupe.— Pas le temps de jouer à ces jeux idiots. Je travaille, calmez-vous. Excusez-moi.
Il se lève, disparaît. Marguerite attend un peu, toujours assise à sa place dans le compartiment, puis se redresse et sort dans le couloir.
Marguerite.— Zut, encore loupé. Y’a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ; cette fois-ci, je ne peux pas aller plus loin, c’est foutu !
Elle regarde désabusée par la fenêtre. Il revient.
Bruno.— Vous êtes une drôle de bonne femme, mais désolé, je n’ai pas la tête à ça.
Marguerite.— À ça ?
Bruno.— Vous riez, vous vous distrayez pour passer le temps, peut-être ; je ne vous suis pas, et pour tout vous dire, ce jeu ne m’amuse qu’à moitié.
Marguerite, tout d’un coup sérieuse.— Ce n’est pas forcément un jeu.
Bruno.— Qu’est-ce que vous voulez dire ? Marguerite hésite puis se lance ; petite voix, presque au bord des larmes. — En fait… en fait… En fait, je vais vous dire ; c’est vrai que j’ai quitté mon mari ce matin ; c’est vrai que j’ai mis mon gamin à l’abri et que je vais me cacher chez une amie. Tout d’un coup, j’ai peur ; peur qu’il me rattrape, peur de ce qui va se passer après, peur d’être seule.
Mes copines célibataires ne parlent que de leur liberté retrouvée, elles disent du mal des hommes mais passent des heures sur le minitel et s’envoient en l’air avec n’importe qui, histoire de dire qu’elles ont un mec, sauf que c’est jamais le même.
En attendant, elles ont toutes des chats, et le soir, quand elles rentrent chez elles, y’a personne qui les attend… sauf le chat.
Marguerite le prend par la veste. -J’ai la peur au ventre de me retrouver seule. Une femme avec un enfant, qui en voudrait ?
Bruno.— N’exagérez pas, vous êtes charmante.
Marguerite.— Oui, pour s’amuser j’en trouverai bien un, mais pour de vrai ?
Elle le lâche, fait quelques pas, se retourne vers lui, très sérieuse. -Y avait pas tout de mauvais chez lui. On avait même des bons moments… quelquefois, au début… Les amis qui venaient, les discussions, on refaisait le monde. Un verre de vin, quatre rondelles de saucisson.
Le temps ? L’usure ? On s’est embourgeoisés ! On vivait ensemble mais on ne se voyait plus, on ne se parlait plus ; il s’est inscrit au sport et filait au tennis, d’abord une heure ou deux de temps en temps, puis tous les jours, et pour finir, même le samedi et le dimanche. C’est là que les scènes ont commencé, les cris, les coups, les querelles pour tout, pour rien, mais au moins on existait encore l’un pour l’autre, ou plutôt, l’un contre l’autre.
Elle continue comme si elle se parlait à elle-même.
Je me disais alors que, peut-être, ce qui lie les couples, ce sont aussi les loupés, les non-dits, les non-faits ; qu'il n’était pas si mauvais.
J’espérais un je ne sais quoi, ballottée entre mes rêves et le tristement réel. Et puis je suis devenue transparente ; même pas un meuble, on se cogne dessus, il existe. Non, transparente. Il rentrait pour manger et dormir, c’est tout.
Elle s’adresse de nouveau directement à lui. -C’est vrai qu’en plus, c’était un bosseur, architecte ; mais la réussite sociale, je m’en fous, ce n’était plus une vie.
Le ton est monté, les coups ont redoublé, j’ai eu peur, il changeait ; et me revoilà à la case départ.
Avec un petit sourire triste. -Je vous ai vu ; vous ressembliez à un ours et vous m’avez plu. Alors j’ai été très bête, pour attirer votre attention j’ai parlé, encore parlé.
Partir, ce n’est rien, tout est affaire de choix : qu’est-ce que j’emporte, qu’est-ce que je lui laisse ? Ça a été vite fait, j’ai pris mes fringues, celles d’Antoine, et rien d’autre. Si, trois livres et quelques disques ; qu’il garde le reste dans sa belle maison.
C’est l’avant et l’après qui posent problème ; l’avant, je l’ai connu : les hésitations, les décisions, les excuses que je lui trouvais, les marches arrière, la culpabilité, doublée à cause du petit.
Je suis dans le présent, quelques heures de grâce, mais dès ce soir je vais découvrir l’après. Si vous saviez comme j’ai peur de ne pas savoir m’en sortir et peur, j’en ai honte, de peut-être le regretter.
Bruno.— Honte ? Pourquoi ?
Marguerite.— Ce serait tant de souffrances pour rien ! et alors tout serait de ma faute, il ne fallait pas partir.
Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Vous avez votre vie ; même si la mienne est merdique en ce moment, vous avez la vôtre et je vous bouscule.
Bruno, attentif, gentil, puis persuasif.— Pas du tout, je comprends que ce ne soit pas facile pour vous.Vous y arriverez, vous êtes costaud. Vous travaillez ?
Marguerite.— Oui, de ce côté-là pas de problème, je suis infirmière et, où que j’aille, il y a du travail. Je me suis battue pour garder mon autonomie financière, je ne le regrette pas.
Bruno. -Tout ira bien alors. Ne soyez pas inquiète.
Il rentre dans le compartiment ; elle reste dans le couloir.
Marguerite, désabusée.— Quelle andouille ! Je raconte ma vie, c’est pas sexy et ça ne risque pas d’arranger mes affaires. Pour une fois que je flashe sur un homme, me voilà en train de pleurnicher sur son épaule alors que je le sais, tout le monde le sait, ils ont horreur de ça ; soit belle et tais-toi, voilà ce qu’ils cherchent ; le repos du guerrier sans se prendre la tête.
Bon, c’est fichu.
En attendant, il n’a pas été très sympa. « Vous êtes costaud », ça veut dire quoi ? Je ressemble à un déménageur ? « Tout ira bien, ne soyez pas inquiète », c’est d’un conventionnel ; en gros, c’est boucle-la, j’ai d’autres chats à fouetter. Encore un qui ne trouve pas les mots ! Belle excuse quand on ne les cherche pas ; un peu d’empathie, il ne connaît pas non plus. J’aurais aimé qu’il…
Elle n’achève pas sa phrase, rêveuse.
Pour elle, comme si elle se réveillait, de plus en plus exaltée.
— Il est bel homme quand même, zut de zut ! J’adore son côté un peu ahuri d’homme paumé qui regarde partout comme un petit enfant ; avoir tant de défenses, c’est qu’il est fragile, le pauvre chéri. M’envoyer en l’air avec lui, lui faire l’amour ici ou ailleurs, tout oublier dans une folle bacchanale ! J’ai l’envie qui remonte, qui me prend aux tripes !
En plus, quelle belle revanche sur… Sur quoi ? Sur l’autre ? Il s’en fout ! Encore que s’il s’en doutait, il me tuerait ou le tuerait, lui ! Sur la vie ? Je me plains, je me plains, mais c’est presque indécent, il y a des situations bien pires.
Il va me falloir repartir à l’abordage. Qu’est-ce que je pourrais bien faire pour qu’il bande, qu’il bande enfin, qu’il bande pour moi !
Les lumières s’éteignent. Noir absolu.
Juste un spot sur elle, et uniquement sur sa figure ; elle est comme aveuglée ; accusée, elle répond à des questions, de nombreuses questions.Marguerite.
— Je vous dis que je ne le connaissais pas. On a parlé, c’est tout. Il travaillait sur ses dossiers.
_ Non, je vous dis que non, je ne l’ai pas branché, on n’a pas flirté. Vous êtes obsédé ou quoi ?
— Bien sûr qu’il me plaisait, mais comme tous les autres. Un homme sympathique, pas très loquace. On a juste un peu bavardé. Ce n’était pas mon genre. Beaucoup trop sérieux et puis, ce n’était pas le moment.
Elle continue, excédée.
— De tout, de rien, de son métier, du temps qu’il faisait.
Au début je le trouvais même antipathique, un ours, et puis on a parlé, un peu.
— Mais qu’est-ce que vous imaginez ? J’ai rien fait, moi ! À quoi ça rime ? Vous n’en avez pas fini avec vos questions ?
— Qu’est-ce qui aurait mal tourné ?
— Oui, un homme comme un autre, normal quoi !
— Ça fait cinq fois que vous me le demandez ! C’est pas bientôt fini ?
La lumière revient sur scène. Elle est dans le couloir, pensive. Il est retourné s’asseoir mais ne s’est pas plongé dans ses dossiers ; regards un peu dans le vide, dérangé.
Bruno.— Elle est courageuse cette femme, tout abandonner et partir ; son mari architecte… il doit quand même bien gagner sa vie ; il y en a beaucoup qui en auraient simplement profité sans tout remettre en question. J’en connais des tas qui ne se parlent quasiment plus, parmi mes copains ou partout ailleurs.
Il suffit de regarder dans les restos : ils s’emmerdent l’un en face de l’autre et continuent quand même leur vie ensemble, sans avenir, sans espoir, un pas devant l’autre.
Histoire de conventions sociales, de lâcheté, de calcul sordide au nom des enfants, de la respectabilité, du qu’en-dira-t-on ; peut-être aussi qu’ils sont désabusés et veulent s’épargner de nouveaux déboires, qui sait ?
Pour lui–même, dans ses fantasmes.
— Sacrée pouliche ! de la race, de la sauvagerie ! Elle est jeune encore ; non, pas tant que ça… vingt-cinq ? trente ans ? Aux alentours ? Oui, à peu près ! Superbes jambes et beau cul. Un petit coup, un bon coup sûrement !
Il la détaille un peu comme un maquignon ; elle est toujours debout, de dos, appuyée à la barre, regardant le paysage.
Elle s’en sortira car malgré ses airs d’écervelée, elle raisonne quand même. Sa peur de la solitude est légitime, et ses commentaires sur ses amies accrocs du minitel intelligents.
Belle femme, y’a pas !
Ce que je ne comprends pas bien, c’est cette envie qu’elle semble avoir de replonger dedans. Elle a acquis sa liberté, qu’est-ce qu’elle demande de plus ? Les femmes sont curieuses, elles ont toutes le même parcours.
Prenant une voix de femme.
« Je suis déçue, il a changé, je suis transparente, gna, gna, gna… »
Reprenant sa voix normale.
Et elles restent à se lamenter ou bien elles partent, comme celle-là, et du coup c’est :
Voix de femme.
« Comment vais-je faire ? J’ai peur ! »
Voix normale.
Est-ce que c’est si différent pour nous ?
C’est vrai que chez mes amis, c’est plutôt elles, quand ça n’allait pas, qui se sont barrées. Et eux, pauvres cons, ils ont remis ça vite fait, bien fait ! D’abord, « Vive la liberté, je saute sur tout ce qui bouge », étape courte, car en moins de deux, il y a toujours eu une nana pour les embobiner, et rebelote ! On recommence tout à zéro, la romance, la maison, les mioches !
Expérience, sagesse, fatalisme, à croire que l’amour fou, l’amour passion est un brouillon, la deuxième fois, il semblerait qu’il y ait du mieux. Enfin, à voir !
Il se lève, repousse ses dossiers et se retrouve avec elle dans le couloir.
Marguerite, retentant le dialogue avec lui.— Et vous, ça marche ?
Bruno.— Moi ?
Marguerite.— Oui.
Bruno.— Pas de problème.
Marguerite.— Vous avez des enfants ?
Bruno.— Ah non ! et c’est vraiment un choix.
Marguerite.— Mais pourquoi ?
Bruno.— C’est très prosaïque, je ne vais pas vous faire le coup de la responsabilité qu’on a de mettre un enfant de plus au monde, ce n’est pas ça du tout. C’est plutôt l’expérience, le regard que j’ai sur les autres, l’égoïsme, il faut le dire, et puis, mon histoire familiale.
Marguerite.— Ah ?
Bruno, d’abord désabusé puis cynique. — La totale : enfant de divorcés ; ce ne serait que ça, ce ne serait rien, mais ils ont trouvé tous les deux que le mieux était de refaire leur vie. Pour la refaire, ils l’ont refaite ! Mon père s’est remarié avec une dame qui avait déjà deux enfants et lui en a refait deux autres, et ma mère s’est mise à la colle avec une copine.
Marguerite.— Grande famille, diverse, cela peut avoir du bon !
Bruno, explicatif, sans émotion particulière. (Marguerite est très attentive.)
— Erreur, erreur sur toute la ligne ! Au début, quand j’étais petit, j’étais tout content d’aller chez mon père : il me passait tout au prétexte qu’on se voyait peu. Sa tête à elle, sa nouvelle nana ! Avec le recul, je me rends compte qu’elle était jalouse, jalouse d’un enfant c’est ridicule, jalouse du temps que nous passions ensemble lui et moi, jalouse de notre passé dont elle était exclue, et jalouse aussi au nom de ses enfants ! Quel imbroglio !
Ça ne s’est pas arrangé avec le temps.
Marguerite.— Et votre mère ?
Bruno.— Compliqué. Il s’anime. -Je m’en foutais qu’elle soit avec une femme, encore que les copains…, mais il y avait surenchère, à qui des deux femmes m’aimerait le mieux ou voudrait me le montrer ! Étouffant ! Paradoxe : on t’aime, on t’aime mais on n’aime pas, ou plus, les hommes. Je n’y comprenais rien. Tout ça, c’est du passé ; tout le monde a vieilli ; ils sont encore tous là et on fait comme si maintenant.
Marguerite.— Comme si ?
Bruno, désabusé, comme dégoûté.— Tout va, tout va toujours très bien, mieux que bien, exemple parfait aux yeux des autres de l’adaptation, de la diversité, de l’amour familial ! Un temps. -Vous allez donc chez une amie ?
Marguerite.— Temps d’adaptation comme vous dites : j’ai réfléchi longtemps, pesé le pour et le contre, et puis soudain, tout est allé trop vite ! C’est bien du moi ça ! Je vous disais tout à l’heure que j’avais peur, je suis excitée aussi ; une nouvelle tranche de vie, c’est une chance à saisir, vous ne trouvez pas ?
Bruno.— Oui, on peut voir ça comme ça.
Marguerite s’animant ; elle ne cherche plus à le draguer.— Du coup, je me remets de temps en temps à rêver, à faire des plans, à me fixer des objectifs. Je n’ai plus trop le droit de me tromper, ça c’est angoissant. Je m’étais laissée engluer au nom du « J’ai ce qu’il me faut pour vivre », mais je me suis oubliée, moi, mes désirs, mes envies.
Bruno.— Vous semblez avoir une bonne analyse, vous allez rattraper le temps perdu.
Marguerite, s’adressant d’abord au public puis directement à lui.— Déjà, être débarrassée de lui, profiter de l’instant présent et vivre un moment unique ; ce serait bien ! Certains le trouvent dans une église, d’autres au bout de leur pinceau ou de leur plume, pourquoi je ne le vivrais pas là, dans ce train, avec vous ?
Bruno.— Quelle idéaliste ! Vous n’êtes pas encore guérie, vous !
Marguerite, redevenant sérieuse.— Je n’ai peur que d’une chose, enfin, d’une autre chose… car j’ai peur de tout !
J’ai peur de disposer de toutes les libertés ; on s’est assez battues pour, mais aussi de… m’autocensurer. On est bien obligé de se fixer des limites, mais où placer le curseur ? Se retrouver vieille devant la mort avec le regret de choses qu’on n’a pas faites, de phrases qu’on n’a pas dites, du courage qu’on n’a pas eu, c’est terrifiant !
Bruno.— Des paroles, tout ça ! Fixez-vous un but, accrochez-vous, et vous ne prendrez pas trop de bosses.
Marguerite, un peu provocante.— Que faites-vous du merveilleux, de l’impromptu ?
Bruno.— Casse-gueule et rêves de jeune fille ! On ne construit rien sur ça, des idées, du vent !
Marguerite.— Et on ne construit rien non plus d’exaltant en montant ses briques l’une après l’autre, sans un peu de folie…
Bruno.— Libre à vous. Chacun ses choix !
Marguerite hésite puis semble se jeter à l’eau.— Un jour, mais je ne vous embête pas avec mes histoires ?
J’avais vingt ans je crois, et la beauté du diable, je fais la rencontre d’un homme, un vrai ! il était beaucoup plus âgé que moi, un vieux de quarante ans… J’ai ressenti un truc, une espèce de pulsion ; il était archi marié, avec enfants, ça je le savais par d’autres, pour le reste, je m’en fichais. Le courant passe, il passe bien, il n’y avait aucun doute, des regards très explicites, chauds, d’un chaud !
On était début juillet… D’abord, il ne se passe rien, rien du tout. Je rentre chez moi, chambre de bonne aux Abbesses. Je m’embrouille, c’est un détail.
Je réfléchis toute la nuit : un homme marié, ce n’était pas ma tasse de thé, mais à l’époque, on s’en foutait ; valeur bourgeoise ringarde ! Pourtant, il n’était pas question que je foute en l’air, voire même que j’ébranle un tant soit peu, son organisation de vie ; je savais que ce serait sans lendemain.
Prenant un air de conspiratrice. -Au matin, excitée comme une puce, je débarque dans son bureau et je lui dis, de mémoire, un truc du style : « On se plaît. » Là, il manque de me sauter dessus, je l’arrête et je continue : « Je vous propose un deal. »
Comme une maîtresse d’école qui veut expliquer quelque chose à un enfant.
« Pendant un mois, un mois exactement, je suis à vous, de jour comme de nuit. Vous êtes le maître absolu, j’accède à tous vos désirs, quel qu’ils soient ; vous êtes le maître, j’obéis. Quand le mois est passé, on met le point final, on n’en parle plus ! »
Je savais que sa petite famille partait à La Baule, donc c’était facile, une parenthèse !
Eh bien, devinez ce qui est arrivé !
Bruno, après un silence.— Il s’est enfui.
Marguerite, comme s’il était un champion.— Gagné !
Bruno— … Moi, moi, j’aurais relevé le challenge.
Marguerite, se moquant de lui.— Ah oui ?
Bruno— Et… comment l’avez-vous vécu ?
Marguerite.— Je me suis dit que c’était un crétin ! Je vous abandonne encore une minute.
Elle sort.
Bruno.— Elle n’avait pas froid aux yeux ; à vingt ans ! Libération de la femme, l’amour, pas la guerre ! Il ne sait pas ce qu’il a manqué cet homme-là, mais je le comprends, la frousse ! une fille pareille !
« Dans un mois on se quitte, tout est fini ! » Il n’y a rien de moins sûr ! Il a dû se dire qu’il entrait dans une spirale infernale, et qu’elle serait incontrôlable ; c’est ce que j’aurais pensé : avec femme et enfants, trop de risques. Elle est à fuir mais intéressante, il n’y a pas de doute.
… Se mettre sous la dépendance d’un quasi-inconnu, curieux quand même. Surtout à l’époque où ce n’était pas encore, je te prends, je te jette ! En avance cette petite !
… En le choisissant comme maître, c’était donc elle la maîtresse.
Après, les rôles étaient censés s’inverser immédiatement, il prenait en main la suite des opérations.
Imagination, fantasmes au pouvoir.
Presque inquiet. -Qu’est-ce que je ferais, moi, en pareil cas ? Ça coupe les pattes une chose pareille ; phase séduction out ! Pas le temps de chercher, de trouver l’angle d’attaque, c’est fait.
Responsable de tout en un tour de main : la fille, son plaisir, le mien, et il faut tenir un mois… Wouah ! La barre est haut placée.
Trop haut placée.
… En tout cas, elle est originale ; je ne l’ai pas bien regardée en revanche, je l’ai entendue, ça oui. Un tourbillon. Attachante quand même ; j’ai bien cru qu’elle allait se mettre à pleurer tout à l’heure ; j’ai horreur des femmes qui pleurent, elle a assuré. Courageuse !
Bon, je ne vais pas m’attendrir, et son histoire ne m’intéresse pas, j’ai ce foutu dossier.
Bruno regarde dehors, presque avec inquiétude.
Silence. Le temps passe et on voit bien qu’il se pose encore des questions.
Qu’est-ce que j’aurais fait ? Le resto, l’hôtel ? impossible, trop conventionnel : quand ça démarre aussi vite, il faut trouver autre chose ! Encore que, le grand jeu, champagne et palace, y’en a qui craquent. La honte, elles ne le reconnaissent pas, mais c’est vrai, elles craquent ! Sous la femme, la romance !
Il réfléchit. -Non, ce n’est pas son genre, mais qu’est-ce qui est son genre ? Romantisme et balades au bord de l’eau ? Pas plus !
Perplexe -Je vous obéis, je vous obéis…Le chemin est tracé, elle veut… Elle veut quoi ? Une femme qui ne fait qu’obéir, ce n’est pas si intéressant que ça, donc il faut épicer les choses, monter un scénario, Ouh ! Compliqué !
Et puis, jusqu’où voudrait-elle aller ? Ce ne sont peut-être que des mots, comment le vérifier ?
Marguerite arrive lentement, soucieuse. — J’espère que Céline a bien eu mon message, qu’elle sera à l’arrivée, sinon c’est la cata. Tout s’est tellement vite passé. C’est que j’ai un drôle de barda. Il faut aussi que je pense à appeler maman, elle n’est vraiment pas contente. Sa fille qui divorce ! ça va blablater au pays ! Elle s’y habituera. Antoine avait une toute petite mine quand je suis partie. C’est chiant, ce pauvre gosse, il morfle à cause de nous ; bon, il n’est pas le seul mais quand même, je suis toute retournée.
Marguerite voit Bruno un peu plus loin et continue ; elle n’est plus vraiment dans le trip ; l’exaltation est retombée.
- Tiens, il est là, lui ? Je me laisserais bien faire s’il se décidait, mais apparemment ce n’est pas un aventurier ; un métier, ses dossiers, une vie tranquille et des chaussures cirées, ouais, elles brillent ! Il est bien fringué, un peu trop bon chic, bon genre, mais bien ! Mais la cravate, on croit rêver ! il doit dormir avec. Mode ou pas mode, on pourrait lui dire que ça fait belle lurette que le col roulé ou la chemise ouverte, c’est admis quand on n’est pas en représentation.
Marguerite hoche la tête, se confortant dans son avis, mais avec moins de passion.
Il a de la gueule, oui, c’est vrai, il a de la gueule. Mais non, trop sage, trop conventionnel, trop comme lui, comme l’autre, et je sors d’en prendre ; non, pas vraiment mon genre. Faut que je me calme !
Ils sont dans le couloir et se rapprochent l’un de l’autre.
Bruno.— C’est curieux ce que vous m’avez dit tout à l’heure.
Marguerite, riant.— Quoi donc ? Je vous ai fait une tête au carré.
Bruno, sérieux.— Cette expérience que vous avez voulu tenter avec un ami.
Marguerite reste interrogative, comme si elle ne comprenait pas. Bruno continue.
Oui, celui à qui vous avez proposé de passer un mois ensemble.
Marguerite.— Ah oui, ça !
Bruno.— Je me demandais ce que vous entendiez par « Je vous obéis » ?
Marguerite relève la tête, toujours provocante mais un peu gênée.— C’était de la folie, j’étais un peu survoltée à ce moment-là, je me suis assagie !
Faut dire, faut dire que je venais de finir Histoire d’O, vous l’avez lue ?
Bruno.— Oui, il y a longtemps.
Marguerite, toute excitée.— J’étais toute chamboulée ; jamais, à l’époque, je n’aurais imaginé un rapport pareil entre un homme et une femme. Un choc ! un vrai choc ! Je me suis lancée dans un trip incroyable, pourquoi pas moi, il fallait que j’essaie, et tout de suite !
Bruno— C’est pourtant d’une grande violence : tout accepter d’un homme au prétexte qu’on est amoureuse !
Ça pourrait aussi être vrai dans l’autre sens ?
Rêveur quelques instants, il revient à elle.
Un homme qui dépend d’une femme…
Je ne crois pas que cela ait été le thème d’un roman ou alors, méconnu.
Se mettre sous la dépendance d’une femme…
Choisir sa déesse, obéir à ses caprices, attendre sa récompense, et il n’y en a qu’une : être autorisé à l’aimer ! Lâcher prise, redevenir petit enfant et craindre la fessée…
Marguerite fait la grimace puis, comme si elle n’avait pas entendu l’allusion.— Je hais la tiédeur, je détestais mes flirts d’alors pour leur mièvrerie ; du reste, je ne regardais que les hommes nettement plus âgés. Avec le temps, c’est le contraire !
Je plaisante. C’est plus compliqué que ça.
Bruno.— Plus compliqué ?
Marguerite.— Je me suis vraiment posé la question de comment fonctionnait ce type de rapports, de ce j’aimerais ou non… j’ai exploré !
Bruno.— Et alors ?
Marguerite, riant d’elle-même puis crescendo.— J’ai découvert qu’il fallait trouver le bon partenaire ! Indispensable mon cher Watson !
Mais pas si facile d’aborder quelqu’un et de lui dire…
« Prêtez-moi ! Donnez-moi ! Tuez-moi ! Attachez-moi au radiateur, faites-moi marcher à quatre pattes, attachez-moi… c’est comme ça que je prends mon pied ! »
Il la regarde estomaqué ; elle s’interrompt, cherche ses mots.— J’ai…
Elle s’interrompt, ton sérieux et en même temps, jubilatoire. -Être la reine aimée, bien sûr, mais aussi celle pour laquelle le maître‑– puisqu’il faut l’appeler par son nom‑– met tout en œuvre pour la pousser hors des sentiers battus, jusqu’aux limites extrêmes de sa souffrance et de son plaisir. C’est… c’est quelque chose !
Bruno, interrogatif.— Souffrance et plaisir ?
Marguerite, très calmement.— Oui, tout est lié, mais oubliez la jouissance habituelle ; c’est plus dans la tête, il y a une sorte de vertige d’avoir pu se surpasser et d’être allé au-delà de ses limites physiques, morales, voire intellectuelles.
Bruno, stupéfait.— Mais alors, vous l’avez fait ?
Marguerite, ironique.— Ne faites pas cette tête, il n’y a pas mort d’homme, c’est aussi la jubilation du corps !
L’appartenance et la soumission, quand elles ne sont pas imposées par l’homme mais répondent à la demande de la femme, sont les plus puissants des aphrodisiaques. Faites un effort : les jeux se renversent, l’homme entre dans le désir de la femme tout en s’offrant le rôle de maître. Tout le reste est du folklore !
Bruno.— Le reste ?
Marguerite — Les images véhiculées quand on parle de domination, de soumission : les menottes, les fouets et tout le bastringue. Il y a un marché, sûrement très lucratif.
Bruno.— Ah ???
Marguerite, se moquant gentiment de lui et riant.— Vous habitez à Paris ? Allez vous balader à Pigalle, c’est instructif ! J’ai vu des fouets roses, des menottes en fourrure… De quoi faire frémir !
Et prenez la littérature, on ne peut plus lire un bouquin sans une petite scène torride ! Les romans policiers, enfin pas ceux d’Agatha Christie, qui restent d’une sagesse exemplaire, mais les Série Noire, les SAS, qu’est-ce que c’est ? De l’amour, de l’argent, un peu de sang, beaucoup de sexe ! Les bonnes femmes, dans leur cuisine, se sont mises à rêver… Enfin autre chose que le petit coup du samedi soir !
Sade ? Juliette ? Vous connaissez ?
Anaïs Nin ? Ce n’est pas d’aujourd’hui.
C’est un comble que ce soit une petite provinciale qui vous raconte tout ça.
Bruno— Vous… vous avez donc vécu tout cela ? Ce type de rapports où…
Il ne finit pas la phrase, comme gêné.
Marguerite rit de son malaise, ne répond pas mais enchaîne.— Après, je me suis mariée. Il était très… classique.
Bruno.— Et on peut vivre des choses aussi fortes et se marier tranquillement après ?
Comme s’il ne comprenait plus rien Vous ne vous êtes pas… Il fait mine de se barber, elle le coupe.
Marguerite, toujours un peu provocante puis comme un professeur qui rirait de son élève.— Et ne pas s’enkikiner par la suite dans le conventionnel ? C’est ce qui vous inquiète ? Oui, monsieur, pas de doute là-dessus, bien que de temps en temps, une image, un zest de souvenir, ça vaut bien tous les fantasmes que les braves gens ont ! car il y en a qui en ont des gratinés !
À nouveau les lumières s’éteignent. Noir absolu. Spot sur le visage de Marguerite uniquement.
Marguerite.— Il me semblait normal. Un peu fatigué peut-être. Il était toujours dans ses dossiers.
— Qu’est-ce que vous imaginez ? Je ne le connaissais pas. Conversation banale mais intéressante.
Interloquée.
— Des traces de quoi ? Je les aurais vues.
Calme, sûre d’elle.
— Non, il n’a rien tenté du tout. Je lisais, je dormais, il travaillait.
Silence.
— Ça ? C’est plus tard, beaucoup plus tard, vous mélangez tout. On faisait connaissance, on devenait des amis, c’est tout.
Énervée.
— Parce qu’il faudrait qu’on soit présentés et qu’on prenne le thé ? Ça va pas ?
En plus, il y a eu du retard, alors forcément on a commenté d’autant plus qu’on avait senti comme un choc, et à l’idée d’un suicidé, j’étais retournée.
Excédée.
— Non, bien sûr que non, on n’a pas su ce qui s’était passé mais on se raconte des histoires ! Et la SNCF, elle n’est pas bavarde. Vous le savez ? Non ?
Silence.
— OK, je me calme, je me calme, mais toutes ces questions, c’est stupide, ça ne change rien. Qu’est-ce que vous voulez que je vous raconte, allez-y, dites-le et je signe en bas.
Hurlant.
— C’est ridicule. Il était en forme et très normal ; oui, très normal.
Ça fait quinze fois que vous me le demandez ; s’il avait peur, il l’a bien caché.
Et cet hématome, c’est vous qui l’inventez, non ? Vous êtes tous des tarés.
Les lumières reviennent. Ils sont tous les deux dans le couloir.
Marguerite regarde dehors, lève la tête, interrogative puis pas contente du tout. -Vous avez senti la secousse ? Le train ralentit. On va arriver en retard, je sens qu’on va arriver en retard ! La scoumoune, j’ai la scoumoune depuis quelques temps, quoique je fasse, il y a toujours des trucs qui viennent se mettre en travers de ma route. Ce n’est vraiment pas le moment !
Bruno.— On vous attend à la gare ?
Marguerite — Oui, non, en fait je ne sais pas ; mon amie, je l’ai prévenue, j’ai laissé un message, elle ne m’a pas rappelée, je verrai bien. J’espère qu’il y a une cabine à la gare, ou un bistro d’ouvert. Elle habite dans un trou, je vais pouvoir lâcher du lest et faire le point. C’est ce dont j’ai besoin, du calme.
Bruno.— Comment ferez-vous si elle n’est pas là ?
Marguerite — Elle sera là ; oui, elle sera là. Il ralentit encore, je commence à baliser !
J’ai raison : il s’arrête ! Merde de merde....oh, pardon…
Ding, dong. Voix off.
Notre train est arrêté en pleine voie, pour votre sécurité, merci de ne pas descendre sur la voie avant d’y être invités par les agents de la SNCF.
Marguerite, très contrariée, rentre dans le compartiment ; Bruno la regarde s’éloigner, regard appuyé sur ses jambes.
Marguerite, maugréant.— C’est sûr, on a écrasé quelque chose. Une bête ? Un homme ? C’est affreux.
Bruno l’a suivie ; il répond machinalement mais on le sent très inquiet — Mais non, je n’ai rien senti, vous divaguez.
Marguerite se jetant contre lui.— C’est un mauvais présage ; le malheur est là, je le sais, je le sens.
Bruno, la prenant dans ses bras mais toujours soucieux et regardant au loin par-dessus son épaule.— C’est fou d’avoir une imagination pareille. Dans cinq minutes on repart, il suffit d’une coupure de courant.
Marguerite, se dégageant.— Vous croyez ? Bien ma chance ! On ne va quand même pas continuer à pied ? surtout avec tout mon barda !
Bruno s’adresse au public comme s’il était son confident.— Il ne manquerait plus que ça ! Qu’ils tentent quelque chose, mais quoi ? Stupide, c’est stupide, mais avec eux, il faut s’attendre à tout.
Elle me fout tout par terre cette satanée bonne femme ; je me fais le film à l’envers avec ses histoires de domination, de soumission, de je ne sais quoi. Il faut être un peu dérangé !
Bruno semble se plonger dans ses souvenirs.
Pour lui–même.
— Martine, c’en était une aussi ; elle n’avait pas besoin de tout cela pour prendre du plaisir ! Pour baiser, on a baisé ! Il fallait courir pour la suivre ! Une bombe à tête chercheuse ! Je me suis essoufflé, je l’ai quittée ; nous n’étions pas sur la même planète, mais rien à voir avec celle-là… Avoir vingt ans et rentrer dans une relation sadomaso, il ne faut pas avoir peur.
Magali… Ma Magali aux gros seins… C’était partout : dans le train, dans l’ascenseur, sous les portes cochères, dans les salles d’attente, là, elle devenait folle ; l’idée qu’on puisse nous surprendre l’excitait à mort. Elle m’a épuisé elle aussi.
Silence.
Et toutes les autres… finalement ce n’était que… banal.
Bruno, au public.— Elle me met un doute.
Toutes ces filles, ces femmes, mes compagnes d’un soir voire plus, beaucoup plus, peut-être attendaient-elles autre chose ? Peut-être suis-je passé à côté de leurs envies, de leurs fantasmes, et peut-être auraient-elles pris encore plus de plaisir si je les avais attachées, soumises, menottées ?
Pudeur ? Éducation ? On se sautait dessus mais on ne se parlait pas, du moins pas de ces choses-là. Question de génération ! elle a bien quinze ans de moins que moi ! Belle évolution !
Ce doit être bon de…
Bruno est interrompu, Marguerite apparaît, son billet de train à la main.
Elle piaffe de plus en plus — Où sommes-nous ? Vous en avez une idée ? On devait arriver à … dans une heure, mais il me semble qu’on en est loin. Perdus au milieu de nulle part, à refaire notre passé !
Enfin le mien, parce que le vôtre, motus et bouche cousue, vous ne m’en avez pas beaucoup parlé.
C’est bien la SNCF, je te plante là et je ne te donne aucune explication, encore moins des excuses.
Je vais essayer de dormir, c’est la meilleure façon de faire passer le temps. Encore que, tant que je ne saurais pas ce qui s’est passé, jamais je n’y arriverais.
Bruno, la rattrapant.— Non ! restez, qu’on bavarde un peu.
Il ne sait pas comment reprendre la conversation, hésite, n’y arrive pas, puis : -Je vous trouve vraiment très courageuse de tout remettre en question. Vous n’avez pas un autre galant sur les rangs ?
Marguerite, moqueuse.— Vous n’avez rien compris, je sors d’en prendre, ce n’est pas pour m’enfermer à nouveau dans une relation.
Bruno.— Il ne faut pas faire de généralités, il y a des couples qui marchent bien…
Marguerite, toujours moqueuse.— Ah oui, vous en connaissez beaucoup ?
Bruno, embarrassé.— Non, pas beaucoup, c’est vrai, mais vous êtes différente et c’est… enfin je veux dire… Vous… Je pense que la routine, c’est la mort, mais avec vous, on oublie la routine…
Marguerite.— Qu’est-ce qui vous faire dire ça ?
Bruno, de plus en plus embarrassé.— Ben… Ce que je vois : vous êtes super dynamique, entreprenante et… ce que vous m’avez dit, votre expérience, c’est quand même remuant, et ça nous plait, à nous les hommes. Question fantasme, nous sommes souvent dans les mêmes schémas, pas très originaux, il faut le dire, encore que, chacun les siens ; là, c’est autre chose, mais c’est excitant aussi.
Marguerite, blasée, puis baillant.— Tout ça, c’est du passé, je vous l’ai dit ; la jeunesse !
Je vais dormir une minute.
Marguerite entre dans le compartiment, s’assied, pose son manteau sur elle en guise de couverture. Elle s’adresse au public. — Le pauvre garçon, avec mes histoires, il ressemble à un triton hors de l’eau. Jamais de sa vie il n’aurait imaginé tout cela.
Dans ses pensées. -N’est pas maître qui veut ! et c’est vrai que je ne le vois pas dans l’exercice des rapports un peu… particuliers.
D’abord, il faut aimer les femmes, et je ne suis pas sûre que ce soit son fort ; c’est à coup sûr un ours égoïste ; imaginer des scenarios, chercher quel plaisir nouveau donner à l’autre… j’en doute ! Ce serait perdre son temps, et c’est un hussard qui n’en a pas à revendre !
La position du missionnaire, et encore, sa terre de mission, ce doit être le Larzac !
Elle martèle. -Il faut absolument que je dorme un peu, je ne tiens plus debout.
Du couloir, Bruno la regarde, on sent que les choses ont changé pour lui.
Marguerite bouge, ouvre les yeux, se parle à elle-même.— Jamais je n’y arriverai ; entre ce train qui ne repart pas, l’idée qu’il y a un mort, les gosses et tout ce qui tourne dans ma tête, c’est un manège infernal.
Il s’est quand même un peu décoincé le voisin, mais quelle dégaine quand même !
Se moquant, puis indulgente. En pyjama et charentaises, j’ose pas imaginer, un tue l’amour ! Ce doit être, sous ses airs bourrus, un gentil, et je l’ai traumatisé !
Bruno dans le couloir la regarde bouger, s’agiter, essayer de dormir ; enfin il s’intéresse à elle.
Bruno.— Elle est trop énervée pour dormir. Touchante, un petit oiseau, enfin un gros petit oiseau du style grand babilleur ! Néanmoins, je ne m’y frotterai pas, c’est une maîtresse-femme, elle sait ce qu’elle veut et fonce ! sans parler de ses confidences ! Femme d’expérience ; je n’arrive pas à l’imaginer soumise à un homme.
Autre hypothèse, peut-être pas si idiote : pour exister, elle a voulu se conformer à ce qu’elle croyait être le fantasme masculin et, inconsciemment, elle n’a plus cherché que ce type d’hommes mais…
Jusqu’où est-elle allée ? c’est difficile de le lui demander.
Il se retourne, la regarde encore puis, admiratif. -En plus, c’est une belle fille, en fait une belle femme ; elle garde toutefois, mais il faut bien chercher, une fragilité désarmante qui fait qu’elle est attachante ; elle m’émeut presque.
Aujourd’hui, elle est vraiment mal attifée, mais si on lui retirait toutes ses épaisseurs de fringues, ses bottes de hussarde et le reste, elle ferait bander un régiment !
Avec des jambes comme les siennes, en escarpins hauts et bas noirs, elle doit être superbe. De la gueule, oui, elle a de la gueule !
Retour à la réalité, il fait non de la tête.— Soumettre une fille comme ça, je ne m’y aventurerai pas, trop peur de me planter, de ne pas pouvoir suivre alors que je serais sensé être l’initiateur ; non, ce n’est pas pour moi, c’est plutôt le contraire que j’aimerais.
Il se remet à fantasmer, ferme les yeux et se laisse complètement aller.
Accepter l’inconcevable !
Baiser le bout de ses pieds, obéir à ses ordres, me faire piétiner pour obtenir ses faveurs, répondre à ses caprices les plus fous et ne plus, enfin, me poser de question !
Ce que j’aurais aimé être une femme. Avoir des seins, des fesses, des amants !
Un jour, un mois, pas plus !
Homme objet ! Obéissant à la Femme avec un grand F mais aussi objet d’attention, de soin, de prévenance, de désir… Le rêve !
Et pourquoi pas ? ce peut être un jeu érotique intéressant.
L’érotisme, drôle de chose ! Qui aurait pu penser qu’à mon âge, si on me demandait quelle a été ma première émotion sexuelle, je répondrais sans hésiter Melle Vinceneu, une vieille fille, vieille, très vieille à mes yeux. J’étais en neuvième, au cours Saint-Joseph ; elle avait de ces seins !
Un jour, dans la cour de récré, je me battais, j’étais comme fou, je ne sais plus pourquoi. Elle s’est interposée ; dans la bagarre, j’ai agrippé son pull qui est descendu juste assez pour que je vois, non pas ses seins, mais la petite vallée entre ses seins.
Je la vois encore ! J’y ai enfoui mon nez qui pissait le sang ; elle m’a maintenu contre elle et fichu une raclée, une vraie, rien que d’y penser je bande encore ! Et pourtant, elle n’y allait pas de main morte, Melle Vinceneu !
Bruno reprend ses esprits, tout d’un coup inquiet et fatigué. — Le train repart, c’est bien ; il va peut-être rattraper son retard ; la petite avait vraiment l’air inquiet. Moi, je m’en fiche, personne ne m’attend ce soir, la joie des hôtels de province… sinistre ! L’audience, demain et après-demain ; à moins qu’il n’y ait un vice de procédure et renvoi, ce serait finalement une chance. Il y a un risque de dérapage, ces voyous sont capables de tout, j’en ai bien peur ; assurer leur défense, c’est jouer avec du vitriol car ce n’est pas gagné.
Retour au bercail le plus vite possible. L’affaire Zeroni m’attend, et c’est bien pire.
Il rentre dans le compartiment et reprend ses dossiers.
Marguerite se réveille brusquement, inquiète.
Marguerite.— On est reparti ? je ne m’en suis pas rendu compte. Depuis longtemps ? On est où ? On a combien de retard ? Ils ont dit quelque chose ? Vous avez vu le contrôleur ? Je n’ai rien entendu, j’étais claquée.
S’étirant et étouffant un bâillement.
Ça va mieux maintenant. Je crois que j’ai soif, j’y vais.
Bruno.— Je m’en charge. Pétillante ou gazeuse ?
Marguerite.— Oh, c’est gentil ça, je suis encore tout endormie. Pétillante, bien sûr !
Bruno.— Vous voulez manger quelque chose ?
Marguerite.— Oui, non, je ne sais pas, passez devant je vous retrouve, ça me dégourdira les jambes. Je me refais une beauté, j’arrive.
Seule. J’ai une tête à faire peur ! Par quelle mouche il a été piqué, celui-là ? il devient sympa.
Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Retenter ma chance ? Pourquoi ? Pour qui ?
Mon palmarès ? Je m’en fous ! Encore une histoire sans suite, et puis j’ai la tête ailleurs maintenant. Se sermonnant elle-même. Il faut quand même que je sois un peu sérieuse, ça ne mène à rien, je risque de le regretter car demain, au revoir et merci, il aura assuré ses rendez-vous et se barrera. J’ai tellement d’autres trucs à faire ! Il vaut mieux que j’évite cette connerie. Prenant le public à témoin. D’autant qu’il a quand même un peu de ventre, non ?
Elle s’est recoiffée, s’est remis du rouge à lèvres ; elle défroisse ses vêtements, se regarde encore, sort le rejoindre.
Voix off. Notre train accuse un retard de trente-cinq minutes dû à un défaut de signalisation. La SNCF vous prie d’accepter ses excuses. Prochaine gare d’arrivée : Guéret ; Arrivée prévue à 15 h 08 ; ce train sera ensuite sans arrêt jusqu’à Brive la Gaillarde.
On les entend qui reviennent en riant. Marguerite, encore dans les coulisses.
— Finalement, ce voyage a passé plus vite que je ne pensais ; j’espère vraiment qu’elle sera à l’arrivée.
Marguerite entre dans le compartiment, commence à ranger ses affaires ;
Bruno reste dans le couloir puis passe sa tête dans le compartiment.— Je peux vous aider ?
Marguerite.— Oui, tout à l’heure, me descendre la valise, s’il vous plaît.
Ils ont dit quoi ? 15 h ? 15 heures et quelques ?
Bruno.— Je n’ai pas non plus fait attention, vous avez le temps. Combien de temps resterez-vous à Guéret?
Marguerite.— Trente-cinq minutes de retard, donc il arrivera un peu après 3 heures, c’est sûr.
Elle range, il reste à l’extérieur.
Bruno au public — Elle est vraiment sympa, il faut absolument que je la revois, qu’elle me donne ses coordonnées. C’est un volcan, mais je suis prêt maintenant pour ce genre de femmes. Intelligente, drôle et culottée ; elle a un sens de la répartie, on ne doit pas s’ennuyer avec elle !
Bon, elle a un gosse, et alors ? Il est tout fait, j’échappe aux nuits blanches, aux biberons, aux couches ! En plus, c’est pas mal, c’est un garçon ; on pourra faire des trucs ensemble.
Pour lui-même ; il entre petit à petit dans un fantasme, est de plus en plus excité.
— Au lit, ce doit être quelque chose ! elle a un de ces punchs, il faudra que j’assure. Elle a un truc qui m’excite, c’est dingue.
Un temps.
Sa bouche ; elle n’arrête pas de parler ; tout à l’heure j’étais hypnotisé, je la regardais sa bouche, et elle, je ne l’entendais plus, j’étais dans un état second ; sa bouche qui s’ouvrait, qui se refermait, son sourire, sa langue… Et rebelote, j’ai tout imaginé avec la peur au ventre qu’elle devine mes pensées ! Sa bouche autour de mon… Wouah ! sa bouche ! Pas mal, ses seins aussi ; si je m’écoutais…
À force de reculer, je ne trouverai plus que des vieilles ; c’est une chance une femme comme ça : elle est vraiment bandante et puis elle a un métier, elle est drôle, rapide ; pas d’hésitation, je fonce !
Bruno entre dans le compartiment très décidé
Bruno— Prête ? On échange nos coordonnées ? ce serait sympa de se revoir à Paris ou ailleurs.
Marguerite, indifférente.— Si vous voulez, mais vous savez, nos chemins ne risquent plus de se croiser ; je ne sais pas moi-même où je vais, je suis une SDF ! Bien malin celui qui me retrouvera !
Ces quelques jours chez mon amie, c’est pour ça, échapper à mon mari, prendre du recul et enfin les bonnes décisions.
Après ? Soit je reste dans ma Touraine, soit Paris, soit… Dieu seul le sait !
Bruno.— Un jour vous vous poserez, c’est certain, et j’aimerais ne pas être loin.
Marguerite — Ah bon ? ...Faut pas rêver, je sors d’en prendre, je ne sais pas où je vais, mais c’est sympa de votre part.
Au public. -Après l’heure, c’est plus l’heure ; qu’est-ce qu’il croit le mec ?
Je lui raconte mes exploits et ça le fait démarrer ! Trop tard, mon vieux ! J’ai d’autres chats à fouetter maintenant. Et pour l’amour… toujours… je t’aime… suprême… éternel… c’est… niet !
Bruno sort une carte de visite et la lui tend. Marguerite la regardant— Bruno, Bruno Legendre. Et vous êtes d’où ? Rue Monsieur-le-Prince. Chouette adresse ! C’est à Paris, ça ? Ouais super ! Je saurai où crécher si un jour j’y viens !
Bruno sort son carnet, un stylo.— On se tutoie, c’est plus simple. Tu es d’accord ?
Et toi, comment t’appelles-tu ?
Marguerite.— Marguerite.
Bruno, étonné.— Marguerite ?
Marguerite, riant.— Et oui, Marguerite ! Je t’aime un peu, beaucoup, passionnément, et le reste ! C’est comme ça ; et ce n’est pas tout : Marguerite Bonvain ! C’est d’un moche ! Peut-on trouver plus affreux ? Marguerite Bonvain…
Mieux ! On va faire mieux ! Je reprends mon nom de jeune fille, c’est le moment, et c’est… Attention.
Elle se penche vers lui, surveillant ce qu’il écrit. C’est à coucher dehors… Tchernomirof, comme ça se prononce !
Marguerite éclate de rire et détache les syllabes. -Tcher… no… mi … rof … C’est bon ?
Bruno.— Ton numéro de téléphone ?
Marguerite, riant.— Si tu veux l’avoir lui, mon ex, no problem, je te le donne ! c’est le seul numéro que j’aie… enfin, que j’avais
Bruno.— Alors ton adresse ?
Marguerite.— Alors là, pour être un problème, c’est un problème ! Je ne sais pas encore. Chez ma mère, c’est le même nom, Tcher et la suite ! L’adresse, elle, est facile : 2 rue de la Tour ‑ 36000 Tours. Mais avant qu’elle me renvoie quoique ce soit… surtout la lettre d’un inconnu ; ce n’est pas pour demain, elle est furieuse !
Bruno.— Tours ?
Marguerite, riant.— Oui, tu croyais qu’avec un nom pareil, elle habitait chez les Ruscofs ?
Bruno, en aparté.— Marguerite, c’est un peu suranné, cela ne lui va pas du tout.
Bruno souriant. Pour lui-même.
— Marguerite. C’est joli, non ? En revanche, ce n’est pas très sexy ! Marguerite ! deux qui la tiennent, un qui la nique !
Je ferai avec ! Elle m’excite de plus en plus cette fille, son espèce de petit rire, sa façon de se débattre dans la vie, et son cul ! son cul ! un cul exact !
Bruno, au public.— C’est une sacrée garce, faudra faire gaffe ! Laisser passer une pareille nana, ce serait trop bête !
Marguerite— Attendez, aidez-moi, c’est le moment, c’est du béton cette valise.
J’ai pris des bouquins, c’est malin ça ! on les retrouve partout, à la Fnac®, dans toutes les librairies, non il me fallait les miens ! Vous voyez : je suis folle !
Il descend la valise du filet, s’approche d’elle, tente de l’embrasser, elle se dérobe.
Marguerite.— Ça va pas, le grand méchant ours !
Voix off -Notre train arrive en gare de Guéret. Attention à la marche en descendant du train. Veillez à ne rien oublier. La SNCF espère que vous avez passé un bon voyage et vous prie d’excuser le léger retard dû à un animal errant.
Il porte la valise dans le couloir ; ils vont disparaître. On ne voit plus que lui qui la suit.
On entend Marguerite. — De l’autre côté, sous le siège, vite, j’ai oublié un paquet, c’est le cadeau pour Céline, super important ! Donne la valise, vite, vite ! va me le chercher, trop de monde, passe-le moi par la fenêtre.
On le voit revenir, chercher, trouver le paquet, ouvrir la fenêtre, se pencher, lui lancer.
Bruno.— Tu l’as ? Marguerite, téléphone-moi quand tu seras arrivée.
Marguerite.— Ouais, ouais, mais pas pratique, serai chez Céline.
On ne l’entend quasiment pas, sa voix est couverte par le bruit.
Voix off. -Attention, notre train va partir. Fermez les portières.
Plus de lumière ; noir absolu ; temps qui passe.
Spot sur le visage de Marguerite.
Marguerite.— Mais oui, quand je l’ai laissé, il allait très bien. On a échangé en vitesse nos coordonnées.
Étonnée
— Si je l’ai vu avaler des médocs ? Je ne crois pas, ou je ne m’en souviens pas ; on a été que cinq minutes au wagon-bar, il y avait des militaires, un bruit infernal, et puis j’étais pressée, un peu stressée.
Très affirmative.
— Non, j’ai vu personne !
Si, oui, bien sûr, des voyageurs, mais comme nous.
— Mon mari ? Vous êtes fou à lier !
— Anormal ? Quelque chose d’anormal ? Qu’est-ce que vous voulez qu’il se passe dans un train ?
Lasse.
— Je vous l’ai dit, j’étais inquiète que ma copine ne soit pas à l’arrivée : là j’aurais été dans la merde ; mais elle était là, heureusement.
Sur le même ton fatigué.
— Pas de nouvelles, bien sûr que non ; je ne l'ai pas appelé et il n’avait que l’adresse de ma mère. Qu’est-ce que vous cherchez là ?
— Il n’a parlé de rien et de personne ; je sais seulement qu’il allait jusqu'à Brive.
Martelant les mots.
— Nous n’avions pas pris rendez-vous ; c’est le hasard, le hasard complet.
Excédée.
— Croyez ce que vous voulez, j’en ai rien à cirer.
La lumière revient ; il faut que le spectateur comprenne que quelques jours ont passé. Bruno a changé un accessoire de vêtements mais est toujours dans le train, penché à la fenêtre comme s’il espérait quelqu’un.
Voix off.Le train n° 2841 en provenance de Brive la Gaillarde et à destination de Paris va partir ; prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Ce train sera desservira la gare de Bourges puis sera sans arrêt jusqu’à Paris Austerlitz.
Personne. Il s’assied ; on le sent déçu.
Bruno.— C’était idiot d’espérer, mais on ne sait jamais.
Du bruit. Marguerite apparaît avec tout son barda, le voit.— Pas possible ! je rêve, j’hallucine, un miracle ! Tu es là ? Je te croyais déjà reparti. Si tu savais, si tu savais, l’enfer !
Il la regarde, tout content, il ne répond pas, se lève, l’aide, lui monte la valise.
Marguerite s’assoit, épuisée.— L’enfer ! Des mômes partout, Céline super, comme d’habitude, c’est ma pote, mais débordée ; elle ne s’y retrouve plus. Son Jules, qui n’était pas du tout content de me voir, affalé devant la télé et qui tirait la gueule, un petit divan dans la salle à manger, et le chat, oui, le chat qui a pissé dans mes pantoufles !
C’était pas possible ! En plus, l’autre est sur ma piste.
J’ai tenu combien de jours ? Trois jours de folie ; pour couronner le tout, ils sont dans un bled où il n’y a rien à faire, et moi, les balades dans la campagne, ça me fout les jetons ; le silence m’angoisse, j’ai l’impression d’être emmurée vivante.
J’oubliais le chien ! un dogue allemand, une énorme chose qui me regardait comme si j’étais un rosbif ; je mourrais de peur !
T’as vu le temps en plus ? il n’a pas arrêté de flotter. Non, ce n’était pas poss…
La lumière s’éteint, ils passent dans un tunnel (bruit plus fort du train, puis le bruit diminue).
Marguerite.— On est dans un tunnel, et en plus on s’arrête… Et pourquoi tout est éteint ? Mais qu’est-ce que tu fais ? T’es fou ? Qu’est-ce que tu fais ?
Oui, oui, oui, encore…
Des murmures, des chuchotements, des « encore », des « … » On comprend qu’ils font l’amour. Puis silence sépulcral.
Spot sur le visage de Marguerite.
Marguerite, angoissée puis gênée.— Je l’ai appelé, je l’ai tapé un peu, j’ai… ; j’ai tenté de le rhabiller, enfin, un peu, juste…
Il était trop lourd ; y avait que la veilleuse, je voyais presque rien. Il ne bougeait plus ; il avait les yeux ouverts.
Comme il restait inconscient, j’ai couru au wagon-bar ; j’ai fait vite, le plus vite que je pouvais, il fallait aussi que je me…
Elle ne finit pas sa phrase et fait mine de se rhabiller.— Je crois que je pleurais, pas sûr ; j’avais peur, je ne savais pas quoi faire ; le contrôleur est venu très vite, ils ont fait un appel, y a même eu un médecin.
Terrifiée.
— Bouche à bouche ? Je n’y ai même pas pensé. Je ne sais pas faire. Et puis la lumière est revenue, j’ai eu trop peur.
Son regard… Son regard, encore maintenant, j’y pense sans arrêt.
Criant.
— Comment voulez-vous que je sache ? Il a dû se faire ça en tombant.
— Et, pourquoi j’aurais fait ça ? Je n’ai touché à rien, vous avez bien dû vérifier ; ses affaires sont là.
Le spot s’éteint ; noir absolu.
Voix off de Marguerite.
— Ma chérie, j’ai bien réfléchi à ce que j’allais te dire, quelle réponse j’allais te donner. Voilà ce que tu dois savoir.
Des questions sur ton père ? Tu m’en as toujours posées. Je te répondais qu’il était mort, et c’est vrai. Il est mort brutalement, on a cru à une rupture d’anévrisme. Ce que je ne pouvais pas te dire parce que tu étais trop petite, c’est que notre histoire a été très courte. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes plus ; c’était après la séparation d’avec Philippe ; Antoine n’avait que quatre ans ; Bruno m’a fait une jolie cour. Nous étions très amoureux et avions décidé d’un petit voyage ; au retour, il devait me présenter à sa mère. C’est au cours de ce voyage que tu as été conçue, et que malheureusement il est mort.
J’ai dû répondre aux questions des policiers, une enquête de routine : décès sur la voie publique ; cela n’a pas été facile.
J’ai choisi de ne pas nous imposer dans une autre famille ; du reste, sa mère est morte elle aussi très vite. Il n’avait ni frère, ni sœur. Je ne connaissais personne, je ne voulais pas d’histoire, juste une petite vie tranquille, et puis je te voulais à moi, rien qu’à moi. Je pense avoir bien fait. Tu sais tout. Tu es le fruit d’une belle histoire d’amour, ma fille, mon trésor.
N’en parlons plus, veux-tu !
Jeanne Sialelli laviesenvole@sfr.fr 06 09 37 22 76
